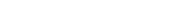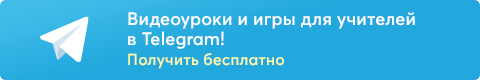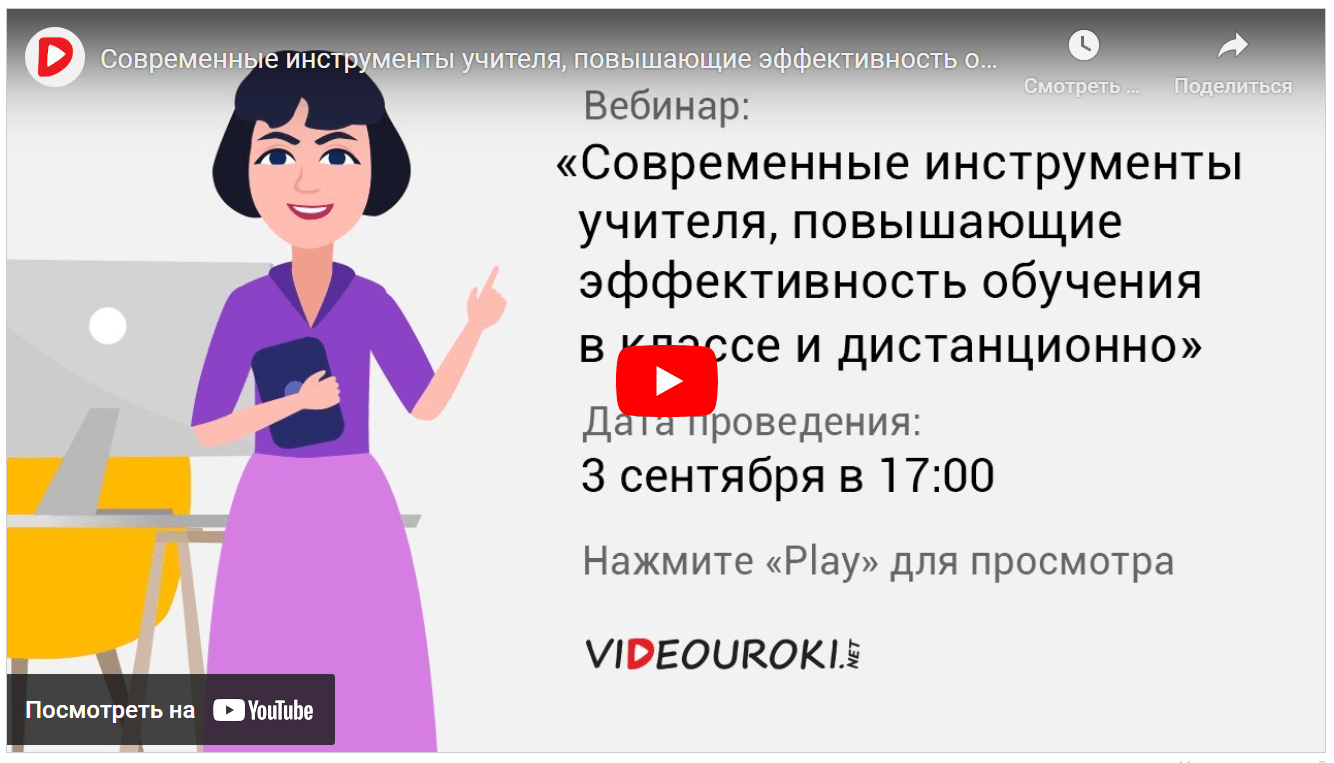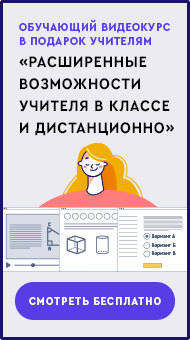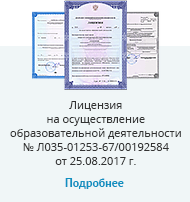Romain Rolland. L'âme enchantée
I. Lisez le texte et répondez aux questions :
1. Quels étaient les intérêts de jeunesse de R. Rolland ?
2. Quelle philosophie personnelle s’est-il forgée ?
3. De quoi était-il passionné à Rome ?
4. Quels ouvrages y a-t-il écrits ?
5. De quoi s’occupe-t-il après le mariage ?
6. Vers quelles idées politiques se tourne-t-il au début du siècle ? Quels ouvrages le montrent ?
7. Dans quel genre se lance l’écrivain ?
8. Quel pressentiment avait-il ?
9. Comment complète-t-il la série des "Vies des hommes illustres" ?
10. Comment est sa vie et son oeuvre pendant la première guerre mondiale ?
11. Pourquoi Rolland n’accepte-t-il pas la révolution russe ?
12. Quel roman commence-t-il en 1922 ?
13. Quels sont ses nouvelles idées philosophiques ?
14. Comment est l’évolution de ses regards envers notre pays ?
15. Quels sont les plus grands ouvrages de R. Rolland ?
16. Comment a été cet homme et cet auteur ?
Romain Rolland
Écrivain français, Romain Rolland est né le 29 janvier 1866 à Clamecy (Nièvre), dans une vieille famille de bourgeois bourguignons de tradition protestante et républicaine. Il passe toute son enfance dans la douceur de la vie provinciale avant de poursuivre ses études à Paris, où sa famille s'installe en 1880.
Il découvre avec enthousiasme les oeuvres de Shakespeare et de Victor Hugo. Reçu en 1886 à l'École normale supérieure de la Rue d'Ulm, où il rencontre André Suarès, agrégé d'histoire en 1889, il lit Nietzsche, Goethe, Spinoza et Tolstoï et se forge une philosophie personnelle, résumée dès 1888 dans Credo quia verum, où s'exprime un panthéisme cosmique.
De 1889 à 1891, pensionnaire à l'École française de Rome, Romain Rolland travaille dans des archives sur l'histoire de la musique. Il découvre Raphaël, Michel-Ange et s'enivre de la lumière romaine. Il s'intéresse surtout à la musique et à la littérature. Amoureux de Mozart, attiré par Beethoven, il se passionne pour Wagner et, grâce à Malwida von Meysenbug, amie de Mazzini, de Wagner et de Nietzsche, il découvre Bayreuth. Il commence à dresser une première ébauche de son futur grand roman, Jean-Christophe, ébauche une théorie du "roman musical", mais s'essaie surtout au théâtre, écrivant en 1891 ses premiers drames: Empédocle, Orsino, Les Baglioni.
Rentré en France, il épouse en 1892 Clotilde Bréal et repart pour l'Italie; il y rassemble la documentation pour ses thèses de doctorat, consacrées à l'Histoire de l'opéra en Europe avant Lully et Scarlatti. De retour à Paris, il assure un service restreint d'enseignement, rédige ses thèses, qu'il soutient en 1895. Il écrit d'autres pièces: Niobé (1892), Caligula (1893), Le Siège de Mantoue (1894); seul Saint Louis (1895) sera publié.
Chargé, en octobre 1895, de cours d'histoire de l'art, il poursuit ses travaux de musicologie et continue d'écrire des drames. Frappé par la décadence de son époque, il commence un Savonarole (1896), inachevé, et met en scène des héros solitaires et purs en butte à un milieu corrompu dans Jeanne de Piennes et Aert (1897).
Il se tourne vers le socialisme. Après un autre drame, Les Vaincus (1897, publié en 1921), il écritLes Loups (1898), inspiré par l'affaire Dreyfus. Il s'intéresse à la Révolution française, en fait le sujet d'autres pièces: Le Triomphe de la raison (1899), Danton (1901), Le Quatorze-Juillet (1902). Le dramaturge épouse les passions des personnages, qu'il montre emportés dans les convulsions de l'Histoire. Comme Richard Wagner, il rêve, à sa manière, de recréer un théâtre à l'image de celui des Grecs, vraiment populaire parce qu'il remettrait en valeur les grandes oppositions élémentaires. Il expose la théorie de sa pratique dans Le Théâtre du peuple (1903). Il écrit encore Le Temps viendra (1903), dénonçant l'impérialisme européen.
Entré en relation avec Charles Péguy, Romain Rolland donne aux Cahiers de la Quinzaine la première de ses grandes biographies où il exprime sa conception d'un héroïsme humanitaire: Vie de Beethoven (1903), un hymne au musicien qui lui permet de vaincre le découragement consécutif à son divorce en 1901. Délaissant le théâtre, il se lance dans le vaste roman d'apprentissage auquel il songe depuis des années: Jean-Christophe, qui introduit en France le genre du roman-cycle, montrant ainsi leur voie à un Jules Romains et à un Roger Martin du Gard. L'ensemble romanesque (1904-1912) comprend dix volumes, répartis en trois séries: Jean-Christophe (L'Aube, Le Matin, L'Adolescent, La Révolte), Jean-Christophe à Paris (La Foire sur la place, Antoinette, Dans la maison), La Fin du voyage (Les Amies, Le Buisson ardent, La Nouvelle Journée). Romain Rolland avait d'abord pensé montrer un héros qui, à l'image de Beethoven, réussissait à atteindre la joie; le projet s'est enrichi et le roman s'est transformé en miroir de la société européenne. Effrayé par la tragédie qui se prépare, il pousse un cri d'alarme et plaide pour une réconciliation des nations.
Parallèlement, il complète la série des "Vies des hommes illustres" (Michel-Ange en 1905-1906 etTolstoï en 1911), renonçant à un Mazzini et à un Hoche prévus. Le musicologue rassemble divers articles (Musiciens d'aujourd'hui et Musiciens d'autrefois en 1908), publie un Haendel (1910).
Il quitte l'enseignement en 1912. Il écrit un roman d'une autre veine: Colas Breugnon, journal tenu pendant un an par un artisan menuisier, qui, malgré les malheurs qui s'abattent sur lui, domine la vie avec sérénité. Mais la guerre survient et l'auteur en diffère la publication jusqu'en 1919. Son ami Charles Péguy, rallié au nationalisme et au catholicisme, est tué lors la bataille de la Marne. Alors en Suisse, Romain Rolland décide d'y rester pour garder une entière liberté. Jusqu'en juillet 1915, il se met au service de l'Agence des prisonniers de guerre. Il écrit plusieurs articles réunis dans Au-dessus de la mêlée (novembre 1915). Ce cri d'appel pacifiste qui plaide pour une réconciliation future est alors aussi mal reçu en France qu'en Allemagne et donne lieu à de furieuses polémiques qui enlèveront à son auteur de nombreuses amitiés malgré le Prix Nobel de littérature qui lui est remis la même année. En 1917, il adresse un Salut à la Russie libre et libératrice, la mettant toutefois en garde contre les excès. Durant la guerre, il tient un journal, qui paraîtra en 1952 (Journal des années de guerre, 1914-1919). Ses réflexions trouvent leurs prolongements dans quelques oeuvres: Liluli (1919) dénonce férocement les idéologies qui mènent les peuples, Clérambault, Pierre et Luce (1920) plaident pour la paix.
Rentré à Paris en 1919, l'écrivain tente une action internationale avec la Déclaration de l'Indépendance de l'Esprit (1919), qui n'eut guère de suite. Déçu par les violences de la révolution russe, il n'accepte pas l'intolérance des partis. Dans sa controverse avec Henri Barbusse (1921-1922), il refuse la dictature communiste et veut "garder l'intégrité de la pensée libre, fût-ce contre la Révolution".
Son idéal pacifiste et internationaliste lui inspire Clérambault en 1920 et l'amène à fonder la revue Europe en 1922. La même année, il part s'installer à Villeneuve, en Suisse. Il commence son deuxième grand roman, L'Âme enchantée, publiant trois volumes: Annette et Sylvie en 1922, L'Été en 1924, Mère et fils en 1927, qui reprennent ses thèmes privilégiés.
Il s'intéresse à l'hindouisme et aux théories de la non-violence, écrit un Mahatma Gandhi (1923). Il entre en relation avec Sigmund Freud et rédigera plus tard Le Voyage intérieur, auto-analyse, portant sur les années 1926-1942, qui exprime sa conception "océanique" de la vie. Il poursuit son "Théâtre de la Révolution": Le Jeu de l'amour et de la mort (1925), Pâques fleuries (1926), Les Léonides (1928).
Il publie La Vie de Ramakrishna (1929), La Vie de Vivekananda et l'évangile universel (1930). Dans la pensée religieuse de l'Inde, Romain Rolland retrouve le contact avec l'Être, source profonde à laquelle il n'a cessé de s'abreuver. Cette croyance, base du Credo quia verum, qui s'exprime dansJean-Christophe, est aussi la philosophie sous-jacente de L'Âme enchantée: Annette Rivière vit dans un contact permanent avec l'Être dans lequel, à la fin de sa vie, le romancier a prévu qu'elle doit se fondre, brisant le dernier enchantement.
Le musicologue revient à Beethoven, dont il étudie les grandes époques créatrices: De l'Héroïque à l'Appassionata (1928) et Goethe et Beethoven (1930) cherchent à retrouver à travers la musique l'âme qui s'y exprime. Il est alors repris par le monde réel. La montée du fascisme en Italie, la politique des nations européennes, les changements en URSS après la mort de Lénine, le conduisent à réviser ses positions et à tenter de "concilier la pensée de l'Inde et celle de Moscou". Comme André Gide à l'époque, il est attiré par le communisme. Dès 1927, plus nettement dans les années suivantes, encouragé par Maria Koudacheva, venue d'URSS, qu'il épousera en 1934, il s'engage aux côtés des communistes. Son Adieu au passé (1931) marque une rupture. Quand il reprend L'Âme enchantée, il se fait le chantre de la Révolution; la vie de Marc, le fils d'Annette, reflète sa propre évolution. Les derniers volumes, La Mort d'un monde et L'Enfantement (1933), portent la marque de son engagement. Malgré tout, il réussit à garder à l'oeuvre son unité: au moment de sa mort, Annette retourne à l'Être.
En 1935, il fait un voyage à Moscou, dont la relation ne sera connue que bien après sa mort. Il publie Quinze ans de combat, Par la révolution la paix (1935), recueils d'articles sociaux et politiques, et Compagnons de route (1936), série d'essais littéraires. Malgré les procès de Moscou (1936-1937), il reste un fervent défenseur de l'URSS. Il poursuit son travail sur Beethoven, publiant en 1937 Le Chant de la résurrection.
En 1938, il quitte Villeneuve et s'installe à Vézelay. Sa dernière pièce, Robespierre (1939), tout emplie d'interrogations sur le devenir des révolutions, pourrait être lue comme une critique de Staline. Mais il faut attendre le pacte germano-soviétique de 1939 pour qu'il flétrisse le régime qu'il avait soutenu. Âgé, l'homme se retire de l'action. Dans sa retraite de Vézelay, durant la guerre, "au seuil de la dernière porte", il revient sur lui-même. En 1939, il commence à rédiger ses Mémoires (posthume, 1956), qu'il interrompt en 1942 pour écrire une biographie passionnée, Péguy (1944), dialogue émouvant et véritable confession spirituelle. Il tente d'achever son grand ouvrage sur Beethoven. Ce sera La Cathédrale interrompue, en trois parties: La Neuvième Symphonie, Les Derniers Quatuors (1943) et Finita Comoedia (1945). Il reste à l'écoute du divin, sentant battre le rythme du monde.
Quand il meurt, le 30 décembre 1944 à Vézelay, il laisse inachevés des Entretiens sur les Evangiles, publiés dans Au seuil de la dernière porte (posthume, 1989). Durant toute sa vie, Romain Rolland a eu de multiples correspondants et il a tenu un journal. Ces documents permettent de découvrir la richesse de ce "beau visage à tous sens", partagé entre Nietzsche et Tolstoï, entre le rêve et l'action, entre l'idéalisme et l'exigence rationaliste.
II. Après la lecture des résumés, répondez aux questions :
1. Où et quand se déroule l’action de ce roman ?
2. Quel est le sujet du roman ?
3. Quels sont les problèmes essentiels qui y sont soulevés ?
4. Qui sont les personnages du roman ?
L'âme enchantée
Résumés
1. Il y a deux Annette Rivière : la jeune bourgeoise sage, intelligente, fortunée, en apparence indifférente à l'amour, et - sous ce masque - la véritable Annette, ardente et droite, avide d'indépendance, inconsciemment en quête d'un compagnon pour qui elle serait une égale. C'est pourquoi elle veut rompre avec le fade et charmant Roger Brissot. Ce mariage lui semble soudain un piège où va s'engluer son âme. Abdiquer, devenir une Brissot ? Impossible. Même le désespoir sincère de Roger ne la fait céder qu'un instant à la pitié. De cet abandon fugitif naît un fils. Seule, bientôt ruinée, elle saura garder la tête haute. Emportée par la vie magicienne, Annette - âme enchantée - suit le destin qu'elle s'est forgé dans le Paris de 1900 à 1914. avant que retentissent les premières salves de la Grande Guerre.
2. Dans son journal, Romain Rolland formule le vœu de créer avec le personnage d’Annette Rivière dans L’Ame Enchantée, un portrait de femme représentant la modernité, un portrait de femme émancipée. Emancipation désignant l’action de s’affranchir d’une autorité, de servitudes ou de préjugés, lesquels varient bien sûr selon l’époque et le lieu.
L’histoire de l’Ame Enchantée se situe essentiellement à Paris, dans la première moitié du XXème siècle. Annette Rivière est issue d’un milieu bourgeois, mais la personnalité de son père la met d’emblée un peu en marge de ce milieu. Aussi s’oriente–t-elle vers des études sérieuses, ce qui est peu habituel pour une jeune fille de la classe aisée. De surcroît, son choix se porte sur les sciences exactes, et elle est déterminée à passer des examens, mettant ainsi en échec les préjugés sur les femmes, sans en être vraiment consciente et surtout sans le viser particulièrement. Que « le mariage ne l’attirait point »1 , n’est que logique dans ce contexte, car mariage signifiait pour elle mariage bourgeois avec le lot de servitudes que l’on connaît.
Le père, veuf, riche et peu conformiste va permettre à Annette de mettre ses projets à exécution. L’entente du couple père/fille devient le garant d’une liberté peu commune, mais il apparaîtra aussi qu’il s’agit d’un fonctionnement en vase clos. La mort du père, qui surviendra assez rapidement, revêtira donc un double aspect. Ce sera d’abord la Emancipation de la femme et forclusion du nom du père dans L’Ame Enchantée Propos sur Romain Rolland 32 remise en question du mode de vie d’Annette Rivière. Et ce n’est pas étonnant qu’ elle se sentira, en quelque sorte, chassée du paradis : « Eve au jardin » sera désormais seule. L’allusion du narrateur à l’histoire de la création n’est pas fortuite, la substitution du nom est voulue, cette pomme de la connaissance n’étant qu’un des éléments qui rapproche ces deux femmes au point que l’on puisse les confondre. Mais l’évocation d’Eve ne restera pas le seul recours à un modèle de femme illustrant des ressemblances de destin telles que la substitution devienne plausible.
Comme Eve, donc, Annette devra désormais se prendre en charge dans un monde qui lui est somme toute étranger : « les souffles inquiétants du dehors étaient entrés »3. Mais« ces souffles de la mort »3 aussi menaçant qu’ils puissent paraître dans un premier temps, révèleront bientôt aussi leur côté positif : « ces souffles de la vie » . Aussi, après un deuil convenu, Annette sera-t-elle prête pour une vie autre où elle finira par trouver l’amour. Ce sera le jeune voisin de sa maison familiale en Bourgogne, fils d’une vielle famille bourgeoise. Ce choix de quelqu’un d’assez proche permettra en définitive d’évaluer le chemin parcouru par Annette Rivière sur la voie de l’émancipation. Très vite, il sera question de mariage et Annette se montre désireuse à s’y engager. Mais sa conception du mariage, fondée uniquement sur l’amour et la compréhension mutuelle, dénuée de toute considération d’intérêt personnel ou familial, va vite se heurter à la conception de la société bourgeoise en question. Roger Brissot, fils unique, ne peut rien décider sans sa famille. Certes, Annette Rivière représente un parti convenable, aussi est-on tout à fait enclin à l’accueillir, mais à condition qu’elle s’intègre dans ce cadre familial et qu’elle abandonne ses propres projets en opposition avec les coutumes de l’époque : « On trouvait un peu d’affectation dans ses travaux en Sorbonne, ses recherches, ses diplômes. Mais on pensait que c’étaient des passe-temps de jeune fille intelligente qui s’ennuie et qu’elle laisse de côté à son premier enfant. Et il ne déplaisait pas aux Brissot de montrer qu’ils aimaient les lumières, même chez une femme, pourvu, naturellement qu’elles ne fussent pas gênantes. »
Annette, au cours d’une longue conversation tente de s’expliquer à son fiancé, seul personne dont l’opinion lui importe. Celui-ci tantôt ne Propos sur Romain Rolland 33 comprend pas, tantôt fait semblant de ne pas comprendre. L’humour et la langue de bois lui servent alternativement d’armure face à une demande d’authenticité à laquelle il n’a pas été préparé. Tel le Roi Lear, qui n’apprécie pas de la part de sa fille Cordelia une franchise, dénuée de tout calcul, lui préférant les flatteries et les mensonges des autres membres de la famille, Roger Brissot restera sous l’emprise de son milieu.
Cordelia est donc l’autre modèle de femme auquel le narrateur compare Annette. Il apparaît alors qu’il ne s’agit pas seulement d’émancipation stricto sensu mais en fait d’authenticité, de vérité intérieure à laquelle on n’arrive que par un véritable travail sur soi-même dans l’esprit du vieux précepte socratique « connais toi toi-même ». Roger Brissot n’est pas prêt et Annette, bien qu’elle l’aime et le désire, ne peut qu’abandonner leur projet commun de mariage. Son ultime geste envers lui sera à la fois la preuve de son amour, la démonstration de son authenticité et l’affirmation de son émancipation. En se donnant à lui, sans arrière-pensée et juste avant de le quitter, elle enfreint doublement la loi de son milieu et prouve ainsi son indépendance d’esprit. Comme il fallait s’y attendre, Roger Brissot ne se montrera pas à la hauteur de la situation. En épousant les préjugés de son époque, il confond sérieux et légèreté et lui rendra le départ plus facile. Ce sera donc l’échec du couple homme/femme dans la logique de la pensée de Romain Rolland qui affirmera encore : « Une fois sur mille la nature réussit son coup, réussit le couple. » Bien sûr, il ne s’agit pas là de la conception communément admise du couple mais d’une conception extrêmement ambitieuse, dont le sacré, au sens propre, est loin d’être absent.
Lorsque, après cette rencontre décisive, Annette est enceinte, nul regret ne l’effleure. Mais, au contraire, une grande joie l’envahit à l’idée de mettre un enfant au monde. Devenir fille-mère ne lui fait pas peur, d’en avertir le père ne lui semble pas nécessaire. Elle est désormais déterminée à poursuivre seule sa voie. « Il marche seul qui va le premier. Mais s’il va seul c’est qu’il se sent pionnier. » Cette conviction va justement lui donner sa force dans un monde qu’elle pense être fait par les hommes et qui lui semble être un mélange d’oppression, de renoncement et de mensonge, ce dont elle rend la religion catholique grandement responsable. Les valeurs qu’elle aurait voulu partager avec Roger Brissot et qu’elle voudrait maintenant transmettre à son enfant, sont tout autres. Déjà elle s’adresse dans de longs monologues à cet enfant à naître et leur dialogue, plus tard, ne sera jamais et sous aucun prétexte interrompu, ni même le jour où le fils voudra connaître le nom de son père. Bien qu’Annette soit alors saisie d’une terrible angoisse de le perdre, car, pendant qu’elle se débattait dans les soucis de la vie quotidienne, le père est devenu un parlementaire célèbre, excellent orateur, fascinant surtout les jeunes, elle n’hésitera pas un instant à communiquer les éléments nécessaires à la rencontre père/fils.
L’angoisse d’Annette Rivière aura été infondée, son empreinte sur l’enfant sera indélébile. Tout de suite, le fils « flaira » l’artifice dans le discours de son père et l’authenticité d la mère lui apparaîtra alors sous un nouvel éclat : « ...il bénissait aujourd’hui son inflexible loi de vérité,… elle grandissait en face de l’homme qu’il venait de reconnaître et de renier. »
Le couple mère/fils aura fait ses preuves. Et c’est l’image de « La Mère », qui va maintenant se superposer à l’image d’Annette. En sortant d’un meeting avec son père, le regard de Marc tombe sur une femme du peuple, aux cheveux gris « qui couvre de son regard aimant et douloureux »8 un invalide de guerre qu’elle soutient. L’allusion à une Piéta ne peut être plus claire et la ressemblance d’Annette avec la Vierge Marie est reconnue par le fils. Ailleurs l’auteur-narrateur la compare aux portraits des « Vierges–mères de Vinci et ce sourire émouvant au coin des lèvres où la tendresse et la tristesse se mêlent. »
Il apparaît en fait de plus en plus clairement, que l’authenticité, en quelque sorte l’ultime étape de l’émancipation, mène quasi automatiquement à l’amour et à la compassion.
Cordelia , la seule à faire preuve de générosité envers son père, le Roi Lear, lorsque celui-ci aura tout perdu, en fera une démonstration parfaite en l’accueillant. De même Marc, digne fils d’Annette, ne laissera –t-il parler que son cœur lorsqu’il empêchera de ses mains le lynchage d’un homme par un groupe de fascistes à Florence.
Il paiera son intervention réussie par sa propre mort. Et cette fois-ci Annette sera réellement au centre d’une scène dont on ne pourra pas nier la ressemblance avec une Piéta. « Elle prit le fils mort à pleins bras, elle l’étreignit, elle l’étendit sur ses genou... la face levée vers l’implacable, vers le ciel vide, elle clama, telle une vocifératrice… » Une Piéta dans un ciel vide, voilà ce qui est nouveau. Mais n’est ce pas ce vide justement qu’Annette a toujours essayé de combler par son combat pour l’authenticité en cherchant à libérer ce qu’il y a de divin dans l’être humain. Et même maintenant, dans cette terrible épreuve, elle ne cèdera pas au désespoir. « Jamais elle n’avait pu tolérer les approches du néant. » Sans hésitation, elle endossera alors son dernier rôle, celui de la combattante au « drapeau rouge du sang de son fils et de tous les sacrifiés »12 , afin que leur sacrifice ne soit pas vaine. « Annette n’hésita pas. Elle le ramassa. On ne pouvait plus rester en dehors du combat… La vie est où est la peine des hommes et leur combat sous le soleil et les rafales. » Ainsi Annette Rivière deviendra le porte-parole de l’ultime message spirituel de Romain Rolland, qui prône encore « l’amour vrai est la suprême loi ».
Et pour arriver à cet état, où tous les « enchantements » se sont dissipés, et où il ne reste que l’amour, Annette sera passée par bien des étapes, qu’elle savait nécessaires. « Notre destin, dit Annette. Celui des âmes qui ont à fournir un long chemin. Je le connais. Celui des femmes qui n’ont pas le droit d’arriver à la mort avant d’avoir passé par le triple sacrement de l’amour, du désespoir et de la honte. »14 Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un chemin de croix, mais accompli par une femme. Rien d’étonnant alors que la mort d’Annette a l’air finalement de s’intégrer dans un tout, où le ciel ne paraît pas si vide puisque « …la coulée de vie qui s’échappe est aspirée, dans un vertige passionné, comme par une bouche, vers le haut. »
III. Lisez le fragment du roman et répondez aux questions :
1. Où et quand se déroule l’action de cet extrait ?
2. Quels sont les problèmes qui y sont soulevés ?
3. Qui est Annette Rivière?
4. Comment sont ses sentiments après la rentrée à la maison?
5. Qui était son père ? Comment était-il ?
6. Comment était sa mère?
7. Quelles relations étaient entre les parents et la fille?
8. De quels traits a-t-elle hérité de ses parents ?
9. Comment était l’ancien cabinet de travail de Raoul Rivière ?
10. Pourquoi Annette a-t-elle décidé d’examiner les papiers de son père ?
11. Quelle découverte a-t-elle faite ?
12. Comment s’est passée la rencontre des soeurs ?
13. Quelle était la différence entre Annette et Sylvie ?
14. Donnez les caractéristiques physiques et psycologiques des personnages de ces chapitres.
15. Quels détails ou faits ont une grande valeur dans la narration ?
PREMIÈRE PARTIE
Elle était assise près de la fenêtre, tournant le dos au jour, recevant sur son cou et sur sa forte nuque les rayons du soleil couchant. Elle venait de rentrer. Pour la première fois depuis des mois, Annette avait passé la journée dehors, dans la campagne, marchant et s’enivrant de ce soleil de printemps. Soleil grisant, comme un vin pur, que ne trempe aucune ombre des arbres dépouillés, et qu’avive l’air frais de l’hiver qui s’en va. Sa tête bourdonnait, ses artères battaient, et ses yeux étaient pleins des torrents de lumière. Rouge et or, sous ses paupières closes. Or et rouge dans son corps. Immobile, engourdie sur sa chaise, un instant, elle perdit conscience…
Un étang, au milieu des bois, avec une plaque de soleil, comme un œil. Autour, un cercle d’arbres aux troncs fourrés de mousse. Désir de baigner son corps. Elle se trouve dévêtue. La main glacée de l’eau palpe ses pieds et ses genoux. Torpeur de volupté. Dans l’étang rouge et or elle se contemple nue… Un sentiment de gêne, obscure, indéfinissable : comme si d’autres yeux à l’affût la voyaient. Afin d’y échapper, elle entre plus avant dans l’eau, qui monte jusque sous le menton. L’eau sinueuse devient une étreinte vivante ; et des lianes grasses s’enroulent à ses jambes. Elle veut se dégager, elle enfonce dans la vase. Tout en haut, sur l’étang, dort la plaque de soleil. Elle donne avec colère un coup de talon au fond, et remonte à la surface. L’eau maintenant est grise, terne, salie. Sur son écaille luisante, mais toujours le soleil… Annette, au bras d’un saule qui pend sur l’étang, s’accroche, pour s’arracher à l’humide souillure. Le rameau feuillu, comme une aile, couvre les épaules et les reins nus. L’ombre de la nuit tombe, et l’air froid sur la nuque…
Elle sort de sa torpeur. Depuis qu’elle y a sombré, quelques secondes à peine se sont écoulées. Le soleil disparaît derrière les coteaux de Saint-Cloud. C’est la fraîcheur du soir.
Annette, dégrisée, se lève, un peu frissonnante, et, fronçant le sourcil de dépit irrité pour l’aberration où elle s’est laissée choir, dans le fond de sa chambre, devant son feu va se rasseoir. Un aimable feu de bois, dont l’office était de distraire les yeux et de tenir compagnie, plus que de réchauffer : car du jardin entrait, par la fenêtre ouverte, avec le souffle mouillé d’un soir de premier printemps, le mélodieux bavardage des oiseaux revenus qui allaient s’endormir. Annette songe. Mais cette fois, elle a les yeux ouverts. Elle a repris pied dans son monde ordinaire. Elle est dans sa maison. Elle est Annette Rivière. Et, penchée vers la flamme qui rougit son jeune visage, — en taquinant du pied sa chatte noire qui tend le ventre aux tisons d’or, elle ranime son deuil, un instant oublié ; elle rappelle l’image (de son cœur échappée) de l’être qu’elle a perdu. En grand deuil, au front, aux plis des lèvres, la trace non effacée du passage de la douleur, et le dessous des paupières encore un peu gonflé par les larmes récentes, mais saine, fraîche, baignée de sève comme la nature nouvelle, cette robuste jeune fille, point belle, mais bien faite, aux lourds cheveux châtains, au cou d’un blond hâlé, aux joues, aux yeux de fleur, — cherchant à ramener sur ses regards distraits et ses rondes épaules les voiles dispersés de sa mélancolie, — semble une jeune veuve, qui voit fuir l’ombre aimée.
Veuve, Annette l’était en effet dans son cœur ; mais celui dont ses doigts voulaient retenir l’ombre, était son père.
Il y avait six mois déjà qu’elle l’avait perdu. Vers la fin de l’automne, Raoul Rivière, jeune encore, (il n’avait pas atteint tout à fait la cinquantaine), fut enlevé en deux jours par une crise d’urémie. Bien que, depuis plusieurs années, sa santé, dont il abusait, l’obligeât à des ménagements, il ne s’attendait pas à un baisser de rideau aussi brusque. Architecte parisien, ancien pensionnaire de la Villa Romaine, beau garçon, né malin et doué d’une faim peu commune, fêté dans les salons, comblé par le monde officiel, il avait su collectionner, toute sa vie, sans paraître les chercher, les commandes, les honneurs et les bonnes fortunes. Figure bien parisienne, popularisée par la photographie, les dessins des magazines et la caricature, — avec son front bombé, renflé aux tempes, tête baissée, comme un taureau qui fonce, ses yeux au globe saillant, au regard d’audace, ses cheveux blancs touffus, taillés en brosse, sa mouche sous la bouche rieuse et vorace, un air d’esprit, d’insolence, de grâce et d’effronterie. Dans le Tout-Paris des arts et des plaisirs, chacun le connaissait. Et nul ne le connaissait. Homme à double nature, qui savait admirablement s’adapter à la société pour l’exploiter, mais qui savait aussi se tailler à part sa vie cachée. Homme à fortes passions et à vices puissants, qui, tout en les cultivant, se gardait d’en rien montrer qui pût effaroucher les clients, — qui avait son musée secret (fas ac nefas), mais qui ne l’entr’ouvrait qu’à de très rares initiés, — qui se foutait du goût et de la morale publics, tout en y conformant sa vie apparente et ses travaux officiels. Nul ne le connaissait, ni parmi ses amis, ni parmi ses ennemis… Ses ennemis ? Il n’en avait point. Des rivaux, tout au plus, à qui il en avait cuit de se mettre sur son chemin ; mais ils ne lui en voulaient pas : après les avoir roulés, il avait eu si bien l’art de les enjôler que, comme ces timides sur le pied desquels on marche, ils eussent été près de sourire et de s’excuser. Le rude et matois avait réussi le tour de force de rester en bons termes avec les concurrents qu’il supplantait, et les conquêtes qu’il délaissait.
Il avait été un peu moins heureux en ménage. Sa femme eut le mauvais goût de souffrir de ses infidélités. Quoique, depuis vingt-cinq ans qu’ils étaient mariés, elle aurait eu largement, pensait-il, le temps de s’habituer, jamais elle n’en prit son parti. D’une honnêteté morose, de manières un peu froides comme l’était sa beauté de Lyonnaise, ayant des sentiments forts, mais concentrés, elle n’était aucunement adroite à le retenir ; et elle avait encore moins le talent, si pratique, de paraître ignorer ce qu’elle ne pouvait empêcher. Trop digne pour se plaindre, elle ne put cependant se résigner à ne pas lui montrer qu’elle savait et souffrait. Comme il était sensible, — (du moins, il le croyait), — il évitait d’y penser ; mais il lui gardait rancune de ne pas savoir mieux voiler son égoïsme. Depuis des années, ils vivaient à peu près séparés ; mais, d’un tacite accord, ils le cachaient aux yeux du monde ; et même leur fille Annette ne se rendit jamais compte de la situation. Elle n’avait pas cherché à approfondir la mésintelligence de ses parents ; ce lui était désagréable. L’adolescence a bien assez de ses propres préoccupations. Tant pis pour celles des autres !…
La suprême habileté de Raoul Rivière fut de mettre sa fille de son parti. Bien entendu, il ne fit rien pour cela : c’est le triomphe de l’art. Pas un mot de reproche, pas une allusion aux torts de madame Rivière. Il était chevaleresque ; il laissait à sa fille le soin de les découvrir. Elle n’y avait pas manqué : car elle était, elle aussi, sous le charme de son père. Et le moyen de ne pas donner tort à celle qui, étant sa femme, avait la maladresse de se gâter ce bonheur ! Dans cette lutte inégale, la pauvre madame Rivière était vaincue d’avance. Elle acheva sa défaite, en mourant la première. Raoul resta seul maître du terrain, — et du cœur de sa fille. Pendant les cinq dernières années, Annette avait vécu dans l’enveloppement moral de son aimable père, qui la chérissait et, sans penser à mal, lui prodiguait les séductions qui lui étaient naturelles. Il en fut d’autant plus dépensier avec elle qu’il en trouvait moins l’emploi au dehors ; car, depuis deux ans, il était retenu davantage au foyer par les annonces de la maladie qui devait l’emporter.
Rien n’avait donc troublé la chaude intimité qui mariait le père et la fille, et remplissait le cœur, mal éveillé, d’Annette. Elle avait de vingt-trois à vingt-quatre ans ; mais son cœur paraissait plus jeune que son âge ; il n’était pas pressé. Peut-être, comme tous ceux qui ont devant soi un long avenir, et parce qu’elle sentait battre en elle une vie profonde, elle la laissait s’amasser, sans hâte d’en faire le compte.
Elle tenait à la fois des deux parents : du père, pour le dessin des traits et le sourire charmant qui, chez lui, promettait beaucoup plus qu’il ne pensait, et chez elle, restée pure, beaucoup plus qu’elle ne voulait ; — de la mère, pour la tranquillité apparente, la mesure des manières, et pour le sérieux moral, malgré l’esprit très libre. Doublement attirante, par la séduction de l’un et la réserve de l’autre. On ne pouvait deviner ce qui dominait en elle des deux tempéraments. Sa vraie nature restait encore inconnue. Des autres, comme d’elle-même. Nul n’avait le soupçon de son univers caché. Telle une Ève au jardin, à demi endormie. Des désirs qui étaient en elle, elle n’avait pas eu à prendre conscience. Rien ne les avait éveillés, car rien ne les avait heurtés. Il semblait qu’elle n’eût qu’à étendre le bras pour les cueillir. Elle n’essayait point, assoupie à leur bourdonnement heureux. Peut-être ne voulait-elle pas essayer… Qui sait jusqu’à quel point on tâche à se duper ? On évite de voir en soi ce qui inquiète… Elle préférait ignorer cette mer intérieure. L’Annette qu’on connaissait, l’Annette qui se connaissait, était une petite personne très calme, raisonnable, ordonnée, maîtresse d’elle-même, qui avait sa volonté et son libre jugement, mais qui n’avait eu, jusqu’ici, nulle occasion d’en user contre les règles établies du monde ou du foyer.
Sans nullement négliger les devoirs de la vie mondaine, et sans être blasée sur ses plaisirs, qu’elle goûtait de fort bon appétit, elle avait senti le besoin d’une activité plus sérieuse. Elle tint à faire des études assez complètes, à suivre les cours de la Faculté, à passer des examens, une double licence. D’intelligence vive, qui voulait s’occuper, elle aimait les recherches précises, particulièrement les sciences, où elle était bien douée ; — peut-être parce que sa saine nature sentait le besoin d’opposer, par instinct d’équilibre, la stricte discipline d’une méthode nette et d’idées sans brouillards à l’inquiétant attrait de cette vie intérieure, qu’elle craignait d’affronter, et qui, malgré ses soins, à chaque arrêt de l’esprit inactif, venait battre son seuil. Cette activité claire, propre, régulière, la satisfaisait pour l’instant. Elle ne voulait pas songer à ce qui viendrait après. Le mariage ne l’attirait point. Elle en écartait la pensée. Son père souriait de ses partis-pris ; mais il n’avait garde de les combattre : il y trouvait son compte.
La disparition de Raoul Rivière ébranla jusque dans ses fondations l’édifice ordonné, dont il était, à l’insu d’Annette, le pilier principal. Elle n’ignorait point le visage de la mort. Elle avait fait connaissance avec lui, lorsque cinq ans avant, sa mère l’avait quittée. Mais les traits de ce visage ne sont pas toujours les mêmes. Soignée depuis quelques mois dans une maison de santé, madame Rivière était partie silencieusement, comme elle avait vécu, gardant le secret de ses affres dernières, comme des soucis de sa vie, et laissant après elle, dans le candide égoïsme de l’adolescente, avec une douleur tendre, pareille aux premières pluies de printemps, une impression de soulagement que l’on ne s’avouait pas, et l’ombre d’un remords, que bientôt recouvrit l’insouciance des beaux jours…
Tout autre fut la fin de Raoul Rivière. Frappé en plein bonheur, alors qu’il se croyait sûr de le savourer longtemps, il n’apporta au départ aucune philosophie. Il accueillit les souffrances et l’approche de la mort avec des cris de révolte. Jusqu’au suprême souffle d’une agonie haletante, comme un cheval au galop qui gravit une pente, il lutta dans l’effroi. Ces affreuses images, ainsi qu’en une cire, s’imprimèrent dans l’esprit brûlant d’Annette. Elle en resta, des nuits, hallucinée. Dans le noir de sa chambre, couchée, près de s’endormir, ou réveillée soudain, elle revivait l’agonie et le visage du mourant, avec une telle violence qu’elle était le mourant ; ses yeux étaient ses yeux ; son souffle étaitson souffle ; elle ne les distinguait plus ; dans ses orbites elle percevait l’appel du regard chaviré. Elle faillit être détruite. — Mais une jeunesse robuste jouit d’une telle élasticité ! Plus la corde est tendue, et plus loin rejaillit la flèche de la vie. L’aveuglante lumière de ces images affolées s’éteignit, par son excès, et fit la nuit dans le souvenir. Les traits, la voix, le rayonnement du disparu, tout disparut : Annette, fixant jusqu’à l’épuisement l’ombre qui était en elle, n’y retrouva plus rien. Rien qu’elle-même. Elle seule… Seule. L’Ève au jardin se réveillait sans le compagnon à ses côtés, celui qu’elle avait toujours su près d’elle, sans chercher à le définir, celui qui, dans sa pensée, prenait, sans qu’elle s’en doutât, les formes imprécises encore de l’amour. Et soudain, le jardin perdit sa sécurité. Les souffles inquiétants du dehors étaient entrés : et le souffle de la mort, et celui de la vie. Annette ouvrit les yeux, comme les premiers hommes dans la nuit, avec l’appréhension des mille dangers inconnus embusqués autour d’elle, et l’instinct de la lutte qu’il lui faudrait livrer. Subitement, les énergies assoupies se ramassèrent et, tendues, se tinrent prêtes. Et sa solitude se peupla de forces passionnées.
L’équilibre était rompu. Ses études, ses travaux, ne lui étaient plus rien. La place qu’elle leur avait attribuée dans sa vie lui parut dérisoire. L’autre partie de sa vie, que la douleur venait d’atteindre, se révélait d’une incommensurable étendue. L’ébranlement de la blessure en avait éveillé toutes les fibres : autour de la plaie ouverte par la disparition du compagnon aimé, toutes les puissances d’amour, secrètes, ignorées ; aspirées par le vide qui venait de se creuser, elles accouraient, des fonds lointains de l’être. Surprise par cette invasion, Annette s’efforçait d’en détourner le sens ; elle s’obstinait à les ramener toutes à l’objet précis de sa souffrance : — toutes, l’âpre aiguillon brûlant de la Nature, dont les souffles de printemps la baignaient de moiteur, — le vague et violent regret du bonheur… perdu, ou désiré ? — les bras tendus vers l’absence, — et le cœur bondissant, qui aspire au passé…, ou bien à l’avenir ? Mais elle ne parvenait ainsi qu’à dissoudre son deuil dans un trouble mystère de douleur et de passion et d’obscure volupté. Elle en était, à la fois, consumée, révoltée…
Ce soir de fin d’avril, la révolte l’emporta. Son esprit de raison s’indigna des confuses rêveries, qu’il laissait sans contrôle depuis de trop longs mois, et dont il voyait le danger. Il voulut les refouler ; mais ce ne fut pas sans peine : on ne l’écoutait plus ; il avait perdu l’habitude du commandement… Annette, s’arrachant au regard du feu dans le foyer et à l’insidieuse emprise de la nuit qui était tout à fait venue, se leva et, frileuse, s’enveloppant dans une robe de chambre du père, elle fit la lumière dans la pièce.
C’était l’ancien cabinet de travail de Raoul Rivière. Par les baies ouvertes, on voyait, au travers du jeune feuillage des arbres, clairsemé, la Seine dans la nuit, et sur sa masse sombre qui semblait immobile, les reflets des maisons, dont les fenêtres s’allumaient sur l’autre rive, et du jour qui mourait au-dessus des collines de Saint-Cloud. Raoul Rivière, qui était homme de goût, bien qu’il se gardât d’en user pour satisfaire à l’insipide routine ou aux caprices cocasses de ses riches clients, avait fait choix pour lui, aux portes de Paris, sur le quai deBoulogne, d’un vieil hôtel Louis XVI, qu’il n’avait point bâti. Il s’était contenté de le rendre confortable. Son cabinet de travail eût aussi bien servi pour des travaux galants. Et il y avait lieu de croire que cette vocation n’était pas restée sans emploi. Rivière avait reçu ici plus d’une visite aimable, dont nul ne se doutait : car la pièce avait son entrée directe sur le jardin. Mais depuis deux années, l’entrée ne servait à rien ; et la seule visiteuse avait été Annette. C’était là qu’ils avaient leurs meilleurs entretiens, Annette, allant, venant, rangeant, versant de l’eau dans un vase de fleurs, toujours en mouvement, puis immobilisée soudain avec un livre, pelotonnée dans son coin favori du divan, d’où elle pouvait voir en silence passer la rivière soyeuse, et suivre, sans interrompre sa distraite lecture, une conversation distraite avec son père. Mais lui, assis là-bas, nonchalant et lassé, dont le profil malicieux happait du coin de l’œil ses moindres mouvements, de vieil enfant gâté qui ne pouvait admettre que, là où il était, il ne fût pas le centre de toutes les pensées, la harcelait de pointes, de questions câlines, railleuses, exigeantes, inquiètes, afin de ramener sur lui l’attention d’Annette et de s’assurer qu’elle écoutait bien tout… Jusqu’à ce qu’à la fin, agacée et ravie qu’il ne pût se passer d’elle, elle laissât tout le reste, pour ne s’occuper que de lui. Alors, il était satisfait ; et sur de son public, il lui faisait largesse des ressources variées de son brillant esprit. Il brûlait ses fusées, il effeuillait ses souvenirs. Bien entendu, il avait soin de n’en choisir que les plus flatteurs ; et il les arrangeait ad usum Delphini —, au goût de la dauphine, dont il percevait finement les curiosités secrètes et les répugnances brusquement hérissées : il lui racontait juste ce qu’elle désirait entendre. Annette, tout oreilles, était fière de ses confidences. Elle croyait volontiers qu’elle avait de son père plus que n’avait jamais su en recevoir sa mère. De l’intimité de sa vie, elle restait, pensait-elle, l’unique dépositaire.
Mais un autre dépôt se trouvait en ses mains, depuis la mort du père : c’étaient tous ses papiers. Annette ne cherchait pas en prendre connaissance. Sa piété lui disait qu’ils ne lui appartenaient pas. Un autre sentiment lui soufflait le contraire. Il fallait, en tout cas, décider de leur sort : Annette, seule héritière, pouvait disparaître à son tour ; et ces papiers de famille ne devaient pas tomber en des mains étrangères. Il était donc urgent de les examiner, soit afin de les détruire, soit pour les conserver. Déjà, depuis plusieurs jours, Annette s’y était décidée. Mais quand elle se retrouvait, le soir, dans la pièce imprégnée de la présence aimée, elle n’avait plus le courage que de s’en pénétrer, des heures, sans bouger. Elle craignait, en rouvrant les lettres du passé, un contact trop direct avec la réalité…
Il le fallait pourtant. Ce soir, elle s’y résolut. Dans la douceur diffuse de cette nuit trop tendre, où elle sentait, inquiète, se fondre sa douleur, elle voulut s’affirmer sa possession du mort. Elle alla vers le meuble en bois de rose, mieux fait pour une coquette que pour un travailleur, — un haut chiffonnier Louis XV, — où Rivière entassait, dans les tiroirs à sept ou huit étages, qui en faisaient comme une réduction anticipée et charmante des sky-scrapersaméricains, ses lettres et ses papiers intimes. Annette, s’agenouillant, ouvrit le tiroir du bas ; pour mieux l’examiner, elle l’enleva du meuble ; et, reprenant sa place près de la cheminée, elle le mit sur ses genoux et se pencha dessus. Nul bruit dans la maison. Elle y habitait seule, avec une vieille tante, qui tenait le ménage, et qui ne comptait guère : sœur effacée du père, tante Victorine avait toujours vécu à son service, le trouvait naturel, et maintenant continuait, au service de sa nièce, son rôle de gouvernante, — ainsi que les vieux chats, ayant fini par faire partie des meubles de la maison, auxquels elle était attachée, sans doute, autant qu’aux êtres. Retirée de bonne heure dans sa chambre, le soir, sa présence lointaine à l’étage au-dessus, le va-et-vient paisible de ses vieux pas feutrés, ne dérangeaient pas plus les songeries d’Annette qu’un animal familier.
Elle commença de lire, curieuse, un peu troublée. Mais son instinct de l’ordre et son besoin du calme, qui voulaient que, dans elle et autour, tout fût clair et rangé, s’imposaient en prenant et dépliant les lettres, une lenteur de mouvements, une froideur détachée, qui, quelque temps, du moins, purent lui faire illusion.
Les premières lettres qu’elle lut étaient de sa mère. Le ton chagrin lui rappela d’abord ses impressions de naguère, pas toujours bienveillantes, un peu agacées parfois, avec quelque pitié à l’égard de ce qu’elle jugeait, dans sa haute raison, une habitude d’esprit véritablement maladive : « Pauvre maman !… » Mais, petit à petit, poursuivant sa lecture, elle s’apercevait, pour la première fois, que cet état moral n’était pas sans motifs. Certaines allusions aux infidélités de Raoul l’inquiétèrent. Trop partiale pour juger au détriment de son père, elle passa, affectant de ne pas très bien comprendre. Sa piété lui fournissait d’excellentes raisons pour détourner les yeux. Elle découvrait toutefois le sérieux de l’âme, la tendresse blessée de madame Rivière ; et elle se reprocha, en l’ayant méconnue, d’avoir ajouté aux tristesses de cette vie sacrifiée.
Dans le même tiroir, côte à côte, dormaient d’autres paquets de lettres, — (certaines même détachées, mêlées aux lettres de la mère) — que la tranquille légèreté de Raoul avait réunies ensemble, comme, dans sa vie de ménage multiple, il avait fait des correspondantes.
Cette fois, le calme imposé d’Anhetie se vit soumis à une difficile épreuve. De tous les feuillets de la nouvelle liasse, des voix se faisaient entendre, bien autrement intimes et sûres de leur pouvoir que celle de la pauvre madame Rivière : elles affirmaient sur Raoul leurs droits de propriété. Annette en fut révoltée. Son premier mouvement fut de froisser dans sa main les lettres qu’elle tenait, et de les jeter au feu. — Mais elle les en retira.
Elle regardait, hésitarite, les feuilles déjà mordues par la flamme, qu’elle venait de reprendre. Certes, si elle avait de bonnes raisons, tout à l’heure, pour ne pas vouloir s’introduire dans les querelles passées entre ses parents, elle en avait encore de meilleures pour vouloir ignorer les liaisons de son père. Mais ces raisons ne comptaient pour rien, maintenant. Elle se sentait personnellement atteinte. Elle n’eût pas su dire comment, à quel titre, pourquoi. Immobile, penchée, fronçant le bout de son nez, avançant son museau, avec une moue de dépit, comme une chatte irritée, elle frémissait du désir de relancer au feu les insolents papiers, qu’elle serrait dans son poing. Mais, ses doigts se desserrant, elle ne résista pas à l’envie d’y jeter un regard. Et, brusquement décidée, elle rouvrit la main, redéplia les lettres, effaçant soigneusement du doigt les froissures qu’elle avait faites… Et elle lut, — elle lut tout.
Avec répulsion, — (non sans attrait aussi), — elle voyait passer ces liaisons amoureuses, dont elle n’avait rien su. Elles formaient un troupeau fantasque et bigarré. Le caprice de Raoul, en amour comme en art, était « couleur du temps ». Annette reconnaissait certains noms de son monde ; et elle se rappelait, avec hostilité, les sourires, les caresses, qu’elle avait reçus jadis de telle des favorites. D’autres étaient d’un niveau social moins relevé ; l’orthographe n’en était pas moins libre que les sentiments exprimés. Annette accentuait sa moue ; mais son esprit, qui avait les yeux vifs et railleurs, comme ceux du père, voyait l’application comique de celles qui, penchées, un frison sur les yeux, tirant le bout de la langue, faisaient galoper leur plume sur le papier. Toutes ces aventures, les unes un peu plus longues, les autres un peu moins longues, jamais très longues en somme, passaient, se succédaient ; et l’une effaçait l’autre. Annette leur en savait gré, — froissée, mais dédaigneuse.
Elle n’était pas encore au bout de ses découvertes. Dans un autre tiroir, soigneusement mise à part, — (plus soigneusement, elle dut le remarquer, que les lettres de sa mère), — une liasse nouvelle lui révéla une liaison plus durable. Bien que les dates fussent négligemment marquées, il était facile de voir que cette correspondance embrassait une longue suite d’années. Elle était de deux mains, — l’une, dont l’écriture incorrecte et lâchée, qui courait de travers, s’arrêtait à moitié du paquet, — l’autre qui, d’abord, enfantine, appuyée, s’affirmait peu à peu, et continuait jusqu’aux dernières années, — bien plus, (et cette constatation fut particulièrement pénible à Annette), jusqu’aux derniers mois de la vie de son père. Et cette correspondante, qui lui dérobait une part de cette période sacrée, dont elle pensait avoir eu le privilège unique, cette intruse, doublement, écrivait à son père : « Mon père » !… Elle eut la sensation d’une intolérable blessure. D’un geste de colère, elle rejeta de ses épaules la houppelande du père. Les lettres tombées de ses mains, repliée sur sa chaise, elle avait les yeux secs, et ses joues la brûlaient. Elle ne s’analysait pas. Elle était trop passionnée pour savoir ce qu’elle pensait. Mais, de toute sa passion, elle pensait : « Il m’a trompée !… »
Elle reprit de nouveau les lettres exécrées ; et cette fois, elle ne les lâcha plus qu’elle n’en eût extrait jusqu’à la dernière ligne. Elle lisait, en soufflant des narines, bouche fermée, brûlée d’un feu caché de jalousie, — et d’un autre sentiment, obscur, qui s’allumait. Pas une seconde, l’idée ne lui vint, en pénétrant l’intimité de cette correspondance, en s’emparant des secrets de son père, qu’elle pouvait commettre un délit de conscience. Pas une seconde, elle ne douta de son droit… (Son droit ! L’esprit de raison était loin. Une bien autre puissance, despotique, parlait !)… Au contraire, c’était elle qui s’estimait lésée dans son droit — dans son droit — par son père !
Elle se ressaisit pourtant. Elle entrevit, un instant, l’énormité de cette prétention. Elle haussa les épaules. Quels droits avait-elle sur lui ? Que lui devait il ? — L’impérieux grondement de la passion dit : « Tout. » Inutile de discuter ! Annette, abandonnée à l’absurde dépit, souffrait de la morsure, et goûtait en même temps une amère jouissance de ces forces cruelles qui, pour la première fois, enfonçaient dans sa chair leur cuisant aiguillon.
Une partie de la nuit passa à sa lecture. Et lorsqu’elle consentit enfin à se coucher, sous ses paupières baissées elle relut longtemps des lignes et des mots, qui la faisaient tressauter, jusqu’à ce que le fort sommeil de la jeunesse la domptât, sans mouvement, étendue, respirant largement, très calme, soulagée par la dépense même qui s’était faite en elle.
Elle relut, le lendemain ; bien des fois, elle relut, dans les jours qui suivirent, les lettres qui ne cessaient d’occuper sa pensée. Maintenant, elle pouvait à peu près reconstituer cette vie — cette double vie, qui s’était déroulée, parallèle à la sienne : — la mère, une fleuriste, à qui Raoul avait fourni les fonds pour ouvrir un magasin ; la fille, qui était dans les modes, ou bien dans la couture (on ne savait pas très bien). L’une se nommait Delphine, et l’autre (la jeune) Sylvie. À en juger par le style fantasque, négligé, mais dont le déshabillé ne manquait pas de charme, elles se ressemblaient. Delphine paraissait avoir été une aimable personne, qui, malgré de petites roueries tendues çà et là dans ses lettres, ne devait pas avoir fatigué beaucoup Rivière de ses exigences. Ni la mère, ni la fille ne prenaient la vie au tragique. Au reste, elles semblaient sûres de l’affection de Raoul. C’était peut-être le meilleur moyen pour la conserver. Mais cette impertinente assurance ne froissait pas moins Annette que l’extrême familiarité de leur ton avec lui.
Sylvie occupait surtout son attention jalouse. L’autre avait disparu ; et la fierté d’Annette affectait de dédaigner le genre d’intimité que Delphine avait eue avec son père ; elle oubliait déjà que, les jours précédents, la découverte d’attachements du même ordre lui avait été une sensible offense. Maintenant qu’entrait en lice une intimité beaucoup plus profonde, toute autre rivalité lui semblait négligeable. L’esprit tendu, elle tâchait de se représenter l’image de cette étrangère qui, malgré son dépit, ne l’était qu’à demi. Le sans-gène riant, le tranquille tutoiement de ces lettres où Sylvie disposait de son père, comme s’il eût été sa propriété entière, l’indignaient ; elle cherchait à fixer l’insolente inconnue, afin de la confondre. Mais la petite intruse défiait son regard. Elle avait l’air de dire :
— C’est mon bien, j’ai son sang.
Et plus Annette s’irritait, plus cette affirmation faisait son chemin en elle. Elle la combattait trop pour ne pas s’habituer peu à peu au combat, et même à l’adversaire. Elle finit par ne plus pouvoir s’en passer. Le matin, la première pensée qui l’accueillait, au réveil, était celle de Sylvie ; et la voix narquoise de la rivale lui disait maintenant :
— J’ai ton sang.
Si nette elle l’entendit, si vive fut, une nuit, la vision de la sœur inconnue que, dans son demi-sommeil, Annette tendit les bras, afin de la saisir.
Et le lendemain, courroucée, protestant, mais vaincue, le désir la tenait et ne la lâcha plus. Elle partit de la maison, à la recherche de Sylvie.
L’adresse était dans les lettres. Annette alla boulevard du Maine. C’était l’après-midi. Sylvie était à l’atelier. Annette n’osa point l’y relancer. Elle attendit quelques jours, et elle revint un soir après dîner. Sylvie n’était pas rentrée ; ou elle était déjà ressortie : on ne savait au juste. Annette, qu’à chaque course une impatience nerveuse tenait crispée d’attente tout le jour, s’en retournait déçue ; et une secrète lâcheté lui conseillait de renoncer. Mais elle était de celles qui ne renoncent jamais à ce qu’elles ont décidé ; — elles y renoncent d’autant moins que l’obstacle s’entête, ou qu’elles craignent ce qui va arriver.
Elle alla de nouveau, un jour de la fin mai, vers neuf heures du soir. Et cette fois, on lui dit que Sylvie était chez elle. Six étages. Elle monta, trop vite, car elle ne voulait pas se laisser le temps de chercher des raisons pour rebrousser chemin. En haut, elle eut le souffle coupé. Elle s’arrêta sur le palier. Elle ne savait pas ce qu’elle allait trouver.
Un long couloir commun, sans tapis, carrelé. À droite, à gauche, deux portes entr’ouvertes : d’un logement à l’autre, des voix se répondaient. De la porte de gauche venait sur les carreaux rouges un reflet du couchant. Là habitait Sylvie.
Annette fit : « Toc ! toc ! » On lui cria : « Entrez ! » sans cesser de bavarder. Elle poussa la porte ; la lueur du ciel doré vint la frapper en face. Elle vit une jeune fille, à demi dévêtue, en jupon, épaules nues, pieds nus dans des savates roses, qui allait et venait, en lui tournant le dos souple et dodu. Elle cherchait quelque chose sur sa table de toilette, se parlant toute seule, et se poudrant le nez avec une houppette.
— Eh bien ! Qu’est-ce que c’est donc ? demanda-t-elle, d’une voix qui zézayait, à cause des épingles qu’elle mordait de côté.
Puis, subitement distraite par une branche de lilas, qui trempait dans son pot à eau, elle y plongea le nez, avec un grognement de plaisir. En relevant la tête et regardant ses yeux rieurs dans le miroir, elle aperçut, par derrière, hésitante, sur le seuil de la porte, Annette, auréolée de soleil. Elle fit : « Ah ! » se retourna, ses bras nus levés autour de sa tête, prestement renfonçant les épingles dans la chevelure refaite, puis vint, les mains tendues, — et soudain, les retira, faisant un geste d’accueil, aimable, mais réservé. Annette entra, essayant, mais en vain, de parler. Sylvie se taisait aussi. Elle lui offrit une chaise ; et, passant un peignoir à raies bleues usagé, elle s’assit en face d’elle, sur son lit. Toutes deux se regardaient ; et chacune attendait qui allait commencer…
Qu’elles étaient différentes ! Chacune étudiait l’autre, avec des yeux aigus, exacts, sans indulgence, qui cherchaient : « Qui es-tu ? »
Sylvie voyait Annette, grande, fraîche, la face large, le nez un peu camus, le front de jeune génisse sous la masse des cheveux châtain d’or en torsades, les sourcils très fournis, des yeux larges bleu-clair qui affleuraient un peu et qui, étrangement, parfois se durcissaient, par ondes venues du cœur ; la bouche grande, lèvres fortes, un duvet blond au coin, habituellement fermées, en une moue défensive, attentive, butée, mais qui, lorsqu’elles s’ouvraient, pouvaient s’illuminer d’un ravissant sourire, timide et rayonnant, qui transformait toute la physionomie ; le menton, comme les joues, pleins, sans empâtement, solidement charpentés ; la nuque, le cou, les mains, couleur de miel foncé ; une belle peau bien ferme, baignée par un sang pur. Un peu lourde de taille, le buste un peu carré, elle avait les seins larges et gonflés ; l’œil exercé de Sylvie les palpa sous l’étoffe, et s’arrêta surtout sur les belles épaules, dont la pleine harmonie formait avec le cou, blonde et ronde colonne, le plus parfait du corps. Elle savait s’habiller, était mise avec soin, presque trop pour Sylvie, un soin trop observé : les cheveux bien tirés, pas une boucle folle, pas une agrafe en faute, tout en ordre. — Et Sylvie se demandait : « Et dedans, est-ce de même ? »
Annette voyait Sylvie presque aussi grande qu’elle — (aussi grande, oui, peut-être) — mais mince, fine de taille, tête petite pour le corps, demi-nue sous le peignoir, peu de gorge, grassouillette pourtant, les bras dodus, assise, se balançant sur son petit croupion et les deux mains croisées sur ses deux genoux ronds. Ronds, elle avait aussi le front et le menton ; le nez petit, retroussé ; les cheveux d’un brun-clair, très fins et plantés bas sur les tempes, des boucles sur les joues, et de petits cheveux fous sur la nuque et le cou, blanc, très blanc, et gracile. Une plante qui vit en chambre. Les deux profils du visage étaient asymétriques : celui de droite, langoureux, sentimental chat qui dort ; celui de gauche, malicieux, aux aguets, chat qui mord. La lèvre supérieure se retroussait en parlant, sur les canines rieuses.
— Et Annette pensait : « Gare à qui elle croque ! »
Qu’elles étaient différentes ! Et pourtant, toutes deux avaient, du premier regard, reconnu le regard, les yeux clairs, le front, le pli du coin des lèvres, — le père…
Annette, intimidée, raidie, prit son courage et dit, d’une voix blanche, que glaçait l’excès d’émotion, qui elle était, son nom. Sylvie la laissa parler, sans cesser de la fixer, puis dit tranquillement, avec le sourire un peu cruel de sa lèvre retroussée :
— Je le savais.
Annette tressaillit.