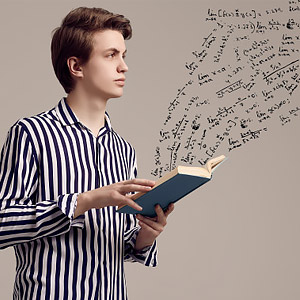Louis Aragon. La Semaine sainte
I. Lisez le texte et répondez aux questions :
1. Qui est Louis Aragon ?
2. Quelle était sa secrète blessure ?
3. Comment était son expérience de guerre ?
4. Qu’est-ce qu’il faisait après la guerre ?
5. Quels mouvements littéraires rejoignait-il ?
6. A quel parti a-t-il adhéré ?
7. Quelle était son attitude envers les événements dans notre pays ?
8. Comment a-t-il été lié avec la Russie ?
9. Comment prenait-il part à la résistance contre le nazisme ?
Louis Aragon
Louis Aragon est un poète, romancier et journaliste français, né probablement le3 octobre 1897 à Paris et mort le 24 décembre 1982 dans cette même ville, à l'âge de 85 ans. Il est également connu pour son engagement et son soutien au Parti communiste français de 1930 jusqu'à sa mort. Avec André Breton, Paul Éluard, Philippe Soupault, il fut l'un des animateurs du dadaïsme parisien et du surréalisme. À partir de la fin des années 1950, nombre de ses poèmes sont mis en musique et chantés par Léo Ferré ou Jean Ferrat, contribuant à porter son œuvre poétique à la connaissance d'un large public (la première chanson tirée d'une œuvre d'Aragon date de 1953 ; composée et interprétée par Georges Brassens, elle reprend le poème Il n'y a pas d'amour heureux, paru dans La Diane française en 1944 mais adapté en la circonstance par le chanteur). Avec l'écrivaine Elsa Triolet, il a formé l'un des couples emblématiques de la littérature française du xxe siècle.
Le nom « Aragon » a été choisi par Louis Andrieux lors de la déclaration de la naissance de l'enfant à l'état civil en souvenir de l'Aragon, connu lorsqu'il était ambassadeur en Espagne. Afin de préserver l'honneur de la famille maternelle, issue des Massillon, et celui du préfet, l'enfant est présenté comme étant à la fois le fils adoptif de sa grand-mère maternelle Claire Toucas, le frère de sa mère et le filleul de son père. L'œuvre de Louis Aragon portera en filigrane la secrète blessure de n'avoir pas été reconnu par son père, de trente-trois ans plus âgé que sa mère. Louis Aragon étudie vers 1907 à l'école Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine, puis poursuit ses études au lycée Carnot.
Il est en deuxième année de médecine avec André Breton au « Quatrième fiévreux » du Val-de-Grâce, le quartier des fous, où les deux carabins se sont liés à Philippe Soupault, quand il est mobilisé, à ce titre, comme brancardier. C'est à cette occasion que Marguerite Toucas lui révèle le secret de naissance qu'il pressentait. Sur le front, il fait l'expérience des chairs blessées, de la violence extrême de la Première Guerre mondiale, d'une horreur dont on ne revient jamais tout à fait mais qui réapparaîtra constamment dans son œuvre et qui est à l'origine de son engagement futur. Il reçoit la Croix de guerre et reste mobilisé deux ans dans la Rhénanie occupée, épisode qui lui inspirera le célèbre poème Bierstube Magie allemande. En 1920, la NRF publie Anicet ou le panorama, roman commencé dans les tranchées.
Dans le Paris dandy de l'après guerre, il commence la rédaction du Paysan de Paris.L'Œuf dur publie quelques-uns de ses textes.
En 1922, il renonce à devenir médecin, fonde avec Breton et Soupault la revue Littérature et publie Les Aventures de Télémaque. Grâce à Breton, il trouve du travail chez le couturier Jacques Doucet, grand collectionneur de tableaux modernes, mais aussi de manuscrits, dans l'achat desquels il le conseille en tant que secrétaire.
Après avoir illustré le dadaïsme et connu les expériences d'écriture automatique auprès de Robert Desnos, auquel il consacrera des années plus tard l'émouvante Complainte de Robert le Diable chantée par Jean Ferrat, il rejoint, en 1924, André Breton, Paul Éluard et Philippe Soupault dans le mouvement surréaliste et cosigne, à l'occasion de l'enterrement d'Anatole France, le scandaleux Un cadavre qui invite à jeter à la Seine toute la littérature passée. Il dévore, comme pour oublier Denise Lévy, les œuvres d'Engels, Lénine, Proudhon, Schelling, Hegel et Freud.
En 1926, démuni, il signe avec Jacques Doucet un contrat par lequel le jeune romancier s'engage à livrer mensuellement sa production au collectionneur en échange d'une rente mensuelle de mille francs. Il écrit ainsi un cycle de mille cinq cents feuillets, La Défense de l'infini..
Avec Breton et après Éluard, il adhère en janvier 1927 au Parti communiste français. À l'été, il fait paraître une violente protestation contre l'exécution de Sacco et Vanzetti dans laquelle il milite pour une littérature engagée, Traité du style.
Le 5 novembre, la belle-sœur de Vladimir Maïakovski, Elsa Triolet, vient le trouver à la brasserie La Coupole avec l'intention de le séduire. Elsa « entre dans le poème » et deviendra sa muse pour la vie, formant avec le poète un nouveau couple mythique.
En 1929, l'expulsion d'URSS de Trotski fige, au sein du groupe des surréalistes, les querelles de personnes en fractures idéologiques. Aragon s'oppose en particulier à un Breton dictatorial qui récuse la forme romanesque et qui juge la poésie seule apte à exprimer l'inconscient.
En 1930, six mois après le suicide de Maïakovski, Aragon est envoyé avec Georges Sadoul au Congrès des écrivains révolutionnaires de Kharkov représenter un mouvement surréaliste accusé d'anarchisme par la ligne dure du PCF. Aragon se range à cette ligne orthodoxe et publie à son retour Front rouge, un poème sous forme d'ode à l'URSS et au marxisme-léninisme, appelant à diverses actions violentes : « l'amas splendide et chaotique qu'on produit aisément avec une église et de la dynamite - Essayez pour voir », dénonçant également l'esthétique surréaliste et le socialisme au cri de « Feu sur Léon Blum », ce qui lui vaut d'être inculpé pour appel au meurtre. La rupture avec Breton, qui, beau joueur, prend tout de même sa défense au cours du procès, est consommée. Avec Elsa, il part vivre un an en URSS. Il montre sans conteste dans plusieurs textes une approbation de la terreur organisée par le régime stalinien. Il écrit notamment en 1931 Vive le Guépéou, hymne aux méthodes totalitaires paru dans le recueil Persécuté persécuteur. Il compose des poèmes qui seront publiés sous le titre Hourra l'Oural.
Il ne deviendra critique à l'égard de l'URSS qu'après la mort de Staline (1953), à la suite des révélations par Khrouchtchev des crimes du stalinisme, et après la répression violente de l'insurrection de Budapest en 1956.
Il épouse Elsa le 28 février 1939. Sa poésie est largement inspirée, depuis les années 1940, par l'amour qu'il lui voue.
Il est aussi, avec Robert Desnos, Paul Éluard, Pierre Seghers, Jean Prévost, Jean-Pierre Rosnay et quelques autres, parmi les poètes qui prirent résolument parti, durant la Seconde Guerre mondiale, pour la résistance contre le nazisme, quoiqu'il faudra attendre l'opération Barbarossa pour le voir s'engager dans cette voie. C'est là le sujet d'une autre blessure profonde : la rupture avec son ami Drieu la Rochelle qui, après avoir « hésité entre communisme et fascisme » (voir : Une femme à sa fenêtre), s'est tourné vers le nazisme, sorte de suicide, qui le poussera à se donner vraiment la mort après laLibération. Il existe aussi des « œuvres croisées » entre ces deux amis : Gilles et Aurélien.
Il se lance dans un roman épique, Les Communistes, qui doit évoquer l'héroïsme des militants dans l'avant-guerre et la Résistance, en défendant et justifiant leur attitude pendant la période du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Il n'écrira finalement que la période allant jusqu'à la bataille de France en 1940.
II. Lisez le texte et répondez aux questions :
1. Où et quand se déroule l’action de ce roman ?
2. Quels événements sont évoqués dans le roman ?
3. Quels sont les problèmes essentiels qui y sont soulevés ?
4. Qui sont les personnages du roman ?
La Semaine sainte est un roman historique de Louis Aragon, paru en 1958.
La Semaine Sainte relate la semaine du 19 au 26 mars 1815 : alors que Napoléon, évadé de l'île d'Elbe, a débarqué au Golfe Juan et remonte vers Paris pour reprendre le pouvoir (épisode dit des Cent jours), le roi Louis XVIII et l'ensemble de sa Maison décident de fuir Paris. Le roman accompagne le roi, son entourage et son armée jusqu'à Béthune, où le souverain décide de gagner la Belgique. Il s'attache à des personnages historiques réels très nombreux, en particulier des maréchaux d'Empire ralliés depuis 1814 aux Bourbons, mais un personnage d'artiste apparaît central: le peintre Théodore Géricault qui a renoncé à son art pour s'engager dans la carrière militaire et qui accompagne le roi Louis XVIII dans sa fuite. Pris dans les difficultés d'un présent indéchiffrable, Géricault et plusieurs autres personnages se posent une question politique et humaine: est-il légitime de quitter le territoire national par fidélité au Roi ? À qui convient-il d'être fidèle ?
Ce roman, à la fois très riche de détails historiques précis, et en même temps invention romanesque décrit une période de l'Histoire où l'indécision est forte : Napoléon va-t-il se réinstaller durablement, Louis XVIII être chassé pour toujours ? Les personnages du roman ne le savent pas mais l'auteur, lui, le sait et c'est en résonance avec une époque de sa vie où tout ce à quoi il croit, le communisme, semble s'écrouler (après les révélations en 1956 du XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique).
Dans ce roman, les personnages sont peints avec humanité, avec toute leur complexité, Théodore Géricault en premier lieu, mais aussi le maréchal Berthier qui se défenestre à Bamberg (Franconie allemande) ou le duc de Richelieu qui négocie durement au Congrès de Vienne, ou encore le duc d'Anzin, fondateur des premières mines dans le Nord, aristocrate et participant des prémisses de la révolution industrielle impulsée par la bourgeoisie. On trouve également, lors d'une réunion secrète dans la vallée de la Somme, des anciens Conventionnels s'interrogeant sur le parti à prendre dans la situation créée par le retour de Napoléon. C'est donc aussi un roman à résonance politique même s'il ne parle plus aussi directement du xxe siècle comme dans ses romans précédents ; il y a cependant des incursions dans ce siècle puisque l'auteur relate aussi comment sa conscience politique s'est développée pendant l'occupation de la Sarre en 1919, en particulier pendant une grève de mineurs allemands à Völklingen ; il souligne en même temps comment, de façon singulière à chaque être humain, que ce soit Louis Aragon, Théodore Géricault ou quiconque, peut se mettre en résonance la vie propre de chacun et la grande Histoire pour conduire à un engagement politique, mais aussi éventuellement à un engagement artistique.
Ce roman de transition va ouvrir toute une autre période féconde de l'œuvre de Louis Aragon où il cherchera toujours à dépasser ses limites, en restant, à travers la tragédie, qu'elle soit politique, ou amoureuse, après la mort d'Elsa Triolet en 1970, fidèle à sa volonté de savoir aimer.
III. Lisez le fragment du roman et répondez aux questions :
1. Où et quand se déroule l’action de ces extraits ?
2. Quels sont les problèmes qui y sont soulevés ?
3. De quelle chambre s’agit-il ?
4. Pourquoi s’y était-on entassé comme on pouvait? Comment y était l’atmosphère ?
5. Pourquoi les officiers avaient Théodore à la bonne ?
6. Que veut dire le désœuvrement inquiet ?
7. Que comprenait l’uniforme de Théodore ?
8. Quel dilemme Théodore tâchait et ne pouvait-il pas résoudre ?
9. De quelle histoire se souvenait Théodore ?
10. Comment Théodore est-il devenu mousquetaire ?
11. Comment Théodore compare-t-il Napoléon et le peintre Gros ?
12. Quelles étaient les pensées de Théodore à propos de Napoléon ?
13. Quelle est la perception de la situation par le peintre Théodore ?
14. Comment comprend-il la catastrophe de l’Empire ?
15. Que et comment pense Théodore de lui-même, de son cheval et de la guimbarde cahotante, de son passager, des mousquetaires et de tout ce feuilleton héroïcomique?
16. Quels détails ou faits ont une grande valeur dans la narration ?
La Semaine sainte
p. 13 à 15
La chambrée des sous-lieutenants n’était éclairée que par la bougie sur la table, et sur le plafond et les murs se repliaient les silhouettes des joueurs. Les vitres sales pâlissaient à peine.
La chambrée des sous-lieutenants... c’est-à-dire qu’à la Caserne Panthémont, où il y a encore deux mois il y avait des gardes-du-corps, envoyés depuis en province, pas plus les sous-lieutenants que les lieutenants n’avaient leur lit, et même les mousquetaires qui, comme les gardes, avaient en fait grade de lieutenant dans l’armée, tous les Parisiens au moins, comme Théodore, par exemple, couchaient chez eux, bien des provinciaux avaient pris chambre à l’hôtel. Mais depuis qu’on était en état d’alerte, on s’était entassé comme on pouvait, et puisque tout le monde était officier, sans trop d’égards pour les grades. Dans la chambrée des sous-lieutenants, des sous-lieutenants qui avaient rang de lieutenants-colonels, il y avait, pour des raisons de relations personnelles, des lieutenants qui n’étaient que mousquetaires à côté des sous- lieutenants qui étaient des lieutenants-colonels. Comme Théodore, par exemple... C’était un peu comme à une école où les anciens prennent avec eux des petits, plutôt qu’un quartier de cavalerie.
Théodore, les officiers l’avaient à la bonne, parce que c’était un cavalier extraordinaire, comme on en voit chez Franconi... Dix jours d’alerte... Dix jours qu’on était les uns sur les autres, les anciens et les bleus, à la bonne franquette. Naturellement, un Théodore couchait près de la porte, puisqu’il était resté un lit, et que chez les mousquetaires, au-dessus, on avait dû mettre des paillasses par terre. Dix jours...
Dix jours d’alerte, cela faisait dix jours qu’ils ne retiraient pas leurs bottes. En campagne, je ne dis pas, mais au Quartier Grenelle ! On dormait, on ne dormait pas. Cela finissait par vous travailler, ces histoires. Encore quand il y avait les postes de garde aux Tuileries, mais depuis le 14, la Garde nationale en était chargée. Ce désœuvrement inquiet. On s’allongeait, on s’assoupissait, on était réveillé en sursaut. Sans parler des farces idiotes. Il y avait de ces marmousets, ici... Il traînait sur les polochons des rêves attardés, les paresseux s’asseyaient dans le noir, ceux qui avaient été de la garde, ceux qui avaient bavardé de lit à lit. Tout cet affolement que les journaux contredisaient !
« Vous avez lu La Quotidienne d’hier ? »
Le mousquetaire gris, dans un mouvement d’humeur, se retourna vers Alfred, son interlocuteur. Un jeune gendarme du Roi venu s’asseoir sur le bord du lit, où lui était étendu, tout habillé, ou presque, botté, son dolman rouge dégrafé, n’ayant ôté que la soubreveste bleu roi, marquée de la grande croix blanche à fleurs de lys, et sa cuirasse dont plastron et dos se voyaient à terre dans la ruelle, appuyés l’un à l’autre comme deux mains jointes. Pour quelle prière ? Alfred était venu bavarder avec son ami, le petit Moncorps, qui était aussi des mousquetaires, et qui se tenait debout, près de lui, regardant avec respect Théodore mal réveillé.
p. 33 à 35
Et pourtant... Ney avait trahi. L’Ogre, ce soir- là, était à Auxerre. Botté ou pas. Trahi comme Drouet d’Erlon, les frères Lallemand... Tous d’ailleurs n’avaient-ils pas été ensemble en Espagne ? Des cavaliers... Des cavaliers, pour Théodore, cela signifiait des gens comme lui. Il avait souvent vu le général Lefebvre-Desnouettes rentrant à cheval, dans son hôtel de la rue de la Victoire, à deux pas de chez lui. Un cheval arabe...
Trahir ? Quand avait-il trahi, Ney, hier ou l’an dernier ? Il y avait une telle confusion en toute chose : tel qui était un héros la veille, le lendemain on le tenait pour un traître. Et ceux qui changeaient de camp étaient-ils vraiment des traîtres ? L’an dernier, c’était qu’ils suivaient peut- être la volonté du peuple, cette soif de la paix, cette fatigue... Maintenant, un Ney, est-ce qu’il choisissait la guerre ? est-ce qu’il était différent de tous ces gens qui ricanaient au passage des compagnies rouges, de ces anciens soldats, qui se battaient en duel pour un mot de travers à Frascati, de bien des bourgeois qui lisaient Le Nain Jaune ? Tant de traîtres, ce n’est pas possible. À partir de quel grade est-ce que cela commençait, la trahison ? Les soldats couverts de médailles, les invalides qu’on rencontrait par tout, ceux qui avaient pris d’assaut les villes, enlevé l’Europe à la baïonnette, dans leurs débris d’uniformes, leur misère évidente, des traîtres ? Il y en avait là, sur la terrasse des Feuillants, que Théodore, longeant la rue de Rivoli, voyait à travers les grilles, formant des groupes d’où des gens s’éloignaient soudain avec de grands gestes. De quoi parlaient-ils ? Toujours du maréchal Ney ?
Théodore se souvenait d’une histoire qu’on lui avait racontée : quand l’Empereur était encore en Russie, et qu’il y avait eu cette extraordinaire aventure, la conspiration des généraux Malet et Lahorie, à Paris... On jurait que les conspirateurs étaient en liaison avec la Grande Armée : il n’y manquait pas de Républicains, qui avaient suivi Napoléon, par une sorte de fidélité militaire, puis qui voyaient dans la marche des Aigles moins l’ambition d’un homme que la possibilité de porter à tous les horizons les idées révolutionnaires... Pourtant, si Malet avait réussi, étaient-ils prêts à la subversion ? On disait qu’un maréchal, là-bas, près de Moscou, dans la neige des bivouacs, était d’accord avec les conspirateurs, et n’attendait qu’un signe pour s’emparer du Corse. Ney, peut-être... On disait que c’était Ney, alors. Mais il s’agissait d’une conspiration républicaine... Pourtant Lahorie était un monarchiste ? Qui avait raison ? Valait-il mieux faire cela quelque part en Russie, qu’aux portes de Paris, comme Marmont deux ans après. Ou à La Fère, comme les frères Lallemand. Et Marmont commandaitla Maison du Roi, aujourd’hui ;
Lefebvre-Desnouettes en fuite, Lallemand en prison. Qu’est-ce qu’ils voulaient tous ces gens-là ? La République... la Terreur, quoi ! Robespierre... Théodore avait deux, trois ans, à l’époque des Jacobins ; qu’en savait-il que ce qu’on lui en avait toujours raconté, son père l’avait élevé dans ses idées à lui, un royaliste prudent qui laissait passer l’orage. Il y avait bien l’oncle Siméon, le régicide... Mais Théodore ne lui avait jamais entendu parler que le langage de la conciliation. On ne l’avait pas consulté, Siméon, avant de mettre son neveu chez les Rouges. L’équipement, la dot du mousquetaire, n’avaient pas paru coûter trop cher à ce père, dont le fils se cassait la tête pour des choses qui n’en valaient pas la peine. Il aimait mieux voir son beau garçon parader dans la Maison du Roi. Puis c’était peut-être passer l’éponge sur toutes les années où il avait bien fallu vivre. Surtout que Théodore, quand il était entré aux mousquetaires, tout semblait calme, définitif... Mais Lyon aux mains de Buonaparte ! Marc-Antoine, dans la plaine de Grenelle, avait trouvé le moyen de pousser un instant son cheval flanc à flanc avec Trick, et il avait soufflé à son ami que Sens, oui. Sens, était tombé sans résistance... Il n’y avait plus l’ombre d’un régiment entre l’Aventurier et Paris, plus l’ombre, il marchait sur Fontainebleau...
Et tout à l’heure, parlant au capitaine-lieutenant de Lauriston, quand Théodore avait reconnu l’arbre au pied duquel avait été fusillé Lahorie... Lahorie était-il un traître ? Du point de vue de Law de Lauriston ? Alors... et maintenant ? Quand on songeait que le jeune Buonaparte et Jacques Law de Lauriston, à l’École militaire, ils devaient être l’un pour l’autre comme les marmousets de tout à l’heure, à côté de son lit au Quartier, Moncorps et le petit Vicomte de Vigny... Le capitaine-lieutenant trahissait-il ainsi sa jeunesse ?
p. 114 à 117
Théodore ne croit plus à rien, ni à personne. II était venu comme un soldat qui a prêté serment, défendre les Princes, non que les Princes lui soient chers, mais parce que l’idée élémentaire du devoir lui dictait cette tâche. Et puis, Napoléon, c’est le Napoléon de la défaite, celui qui a entraîné les armées françaises au fond des neiges, mené cette guerre sournoise et sale en Espagne... le Napoléon qui exigeait de Gros qu’il retirât de ses tableaux les généraux dont il était jaloux, et entendait en être le centre. Théodore respectait Gros, c’était peut-être le seul peintre qu’il aimât parmi les Français vivants. Quand il pensait aux ordres qu’un Baron Denon, au nom de l’Empereur, pouvait passer à un artiste comme lui, devant les grandes compositions qui exprimaient toute son expérience et son génie... ah, les dessins de Gros pour Les Pestiférés ! Et ce n’était jamais assez pour la gloire de cet homme, qui lors du Sacre avait fait circuler dans Paris une statue monumentale sur un char, une statue de lui-même, nu et lauré. Car il fallait à l’Empereur aussi la gloire du corps, la perfection des muscles, de la carrure : ce petit homme jaune, que le pouvoir avait bouffi de graisse, muni d’un ventre... Et partout sa lettre, l’N comme un sceau mis aux monuments, aux hommes, à l’histoire. Cet homme qui était la guerre. On raconte que le matin même de sa mort, un de ses lieutenants les plus fidèles, Duroc, avait dit dans un découragement prophétique : «II nous fera tous tuer... pas un d’entre nous ne rentrera chez lui...» Et Junot qu’il avait fait duc, et rendu fou, en 1813, dans les éclairs de sa folie ne lui écrivait-il pas : «Moi qui vous aime avec l’adoration du sauvage pour le soleil, cette guerre éternelle qu’il faut faire pour vous, je n’en veux plus ! je n’en veux plus !» C’était d’Aubigny qui lui avait raconté cela, qui le tenait du jeune Regnault de Saint-Jean-d’Angély. On était très renseigné sur ces choses rue de Provence, chez la mère de celui-ci : le Marquis de Bellincourt, qui était l’amant de Mme Junot, y venait raconter avec une indiscrétion rare ce qui pouvait le faire valoir aux yeux de la maîtresse de maison.
Oui, mais ces jours-ci, le Bonaparte de Gros, de Gérard, de David... c’était un homme sur les routes, qui se hâtait vers Paris, avec une poignée de soldats, et brusquement l’enthousiasme d’un peuple. J’imagine ces haltes dans des auberges de montagne, les villages traversés, les villes où l’on entre le soir aux flambeaux. C’est déjà un homme de cinquante ans ou presque, avec sa redingote grise déboutonnée, ses bottes, la culotte blanche... Les gens ne se souviennent plus que des drapeaux, des aigles, du soleil d’Austerlitz, et ils accueillent cet homme presque seul comme la négation de tout ce qui leur est tombé dessus depuis 1814, de cette société débarquée d’exil, de ces châtelains qui ont resurgi de l’ombre et passent avec des chasses à courre, de cet énorme parasitisme à frimas, des sottes revanches et des humiliations à la pelle. Ils ont oublié l’énorme vénalité de l’Empire, les dotations, les bénéfices, les pensions. Et Théodore ouvre grands ses yeux et devine la marche et le mensonge, les illusions, il entend au pas lointain des armées reformées clouer les cercueils nouveaux, ouverts, avides. Mais préférer Louis XVIII à Napoléon ! Pourtant il n’y a que cette alternative : ou quel prétendant ? quelle République ?
Pour lui, la vérité, c’est le mouvement du cheval, la course folle où l’on se dépense et s’épuise : le cheval qu’on voit dans les stalles sombres des écuries, plus clair que l’ombre qui l’entoure, comme il bouge, piaffe et s’emporte, frappe les planches du sabot ! Jamais pour Théodore un tableau n’est assez noir, la vie est comme un crime surpris, dont il rêve donner l’image. Entre l’Autre à marches forcées devant qui ceux qui n’ont rien, et les maréchaux transfuges qui, ayant gardé leurs dorures grâce au Roi, semblent soudain pris d’une folie commune, et ce Roi, son Duc de Blacas, ses prêtres de cour, ses Barras pour conseillers, oui, le bruit en court à Paris, les derniers jours Louis XVIII a appelé Barras, Géricault est comme un peintre entre deux tableaux, mais il n’a que l’envie de jeter ses pinceaux, rien en lui ne monte qui l’exalte, il a l’amertume de la duperie plein la gorge. Quoi, il n’aura été que le jeune homme de ce temps, tout le feu de ses veines n’aura brûlé que dans la catastrophe de l’Empire, il est ce cuirassier vaincu qu’il a peint, assis sur son cheval abattu qui agonise... Maintenant cette tragi-comédie où une cour chasse l’autre, où les locataires changent dans les beaux hôtels de Paris, et l’on va assister de nouveau à la distribution des places, c’est un spectacle désordonné qui ne peut être soumis à aucune raison organisatrice, et non ! Théodore ne peindra pas demain le Retour de l’île d’Elbe, où tout s’ordonne sur le geste de convention de l’Empereur, non ! ni cela ni cette pourriture qui tient encore les Tuileries. Oh, ces yeux pleins de bitume qu’il tourne ce soir-là vers l’avenir, le jeune Géricault, qui sent dans ses bras et son cœur un grand vide impossible à combler !
p. 209 – 211
Et voilà qu’abandonnant tout cela derrière lui, il avançait dans ce grand vide, avec l’irresponsabilité du soldat, par des itinéraires que d’autres avaient étudiés pour lui, si même ils en avaient eu les loisirs ! en pleines ténèbres nocturnes, dans cet habit rouge qui le brûlait, invisible, cavalier d’une chasse infernale, au trot prolongé d’une bête exténuée dont il ressentait les souffrances, l’haleine forcée, le pas devenu incertain, butant aux pierres, s’enfonçant dans la boue, sous les rafales de vent et de pluie, pincé malgré le manteau et la sueur, le poids du harnachement, par un froid de neige à la veille du printemps, voilà que Théodore Géricault, et qu’est-ce que c’est que cette guimbarde cahotante malgré ses chevaux frais, eux, de la dernière poste, ce train de voitures, où là-bas en tête un Roi podagre somnole dans les lys des coussins et appuie sa lippe bourbonienne à l’épaule du Duc de Duras, voilà que Théodore Géricault, dans la chevauchée fantastique des mousquetaires, rompus, meurtris, les pieds saignants dans les bottes, les fesses échauffées par les culottes de «fort cuir», près de quinze lieues sans changer de pas, qu’à ces haltes dans l’eau de bourgades dont on se faisait difficilement dire les noms, ou dans les brusques arrêts où l’on risquait se jeter les uns sur les autres, parce qu’une berline avait mal compris un tournant, ou des cavaliers s’étaient lancés en travers de leur propre convoi, le croyant coupé soudain par les voyageurs qui débusquaient d’un chemin de campagne, voilà que Théodore Géricault est pris du vertige de l’homme qui tombe, qui tombe dans le vide ou dans un rêve, il ne sait, conscient à la folie de toutes les\choses insignifiantes de son corps et de son âme, de toutes les pièces de son habillement, de chaque anneau de ses courroies, de la selle et de l’étrier, et de tout ce qu’il a oublié de faire avant de partir, habité de souvenirs exagérément lucides et battus comme un jeu de cartes, à poursuivre une inexprimable angoisse, une pensée unique aux développements sans fin, qui se reprend, se perd, se répète, se brise et se renoue, au trot, au trot de la nuit interminable, étouffante, glacée, au clapotement rapide et répété, sans fin répété des chevaux sur le terrain détrempé, on n’imagine pas les variations de nature d’une route inondée pendant des heures et des heures, le sentiment du gravier, l’épaisse argile, le limon qui se délave, les cailloux qui dévalent, l’enfoncement des ornières, les sabots lourds de boue collante, les flaques soudaines comme si on entrait dans un ruisseau et les variations d’un paysage absent, montées, descentes, courbes de la route, ombres indiscernables, présence spectrale des arbres, des talus, les rares maisons obscures après de longs déserts traversés, le sentiment parfois qu’on a quitté la route à la faveur d’une pente, et soudain des buissons devant soi, le silence renforcé par le vacarme du convoi, le chevauchement des pensées, le sentiment en tous ces hommes d’être des étrangers l’un à l’autre, personne ne vit la même histoire, c’est une fuite de destins individuels, une bousculade d’équipées... au trot, au trot, au trot d’une monarchie qui se déglingue, d’un monde qui roule à l’envers, dans la fuite d’une fausse chevalerie, dans ses habits de théâtre, avec ses étendards neufs, son honneur d’Épinal, sa peur des comparaisons, son arrogance d’enfant qui fait la grosse voix dans le noir, une chaise à roulettes pour trône et le Voltaire de Kehl sous l’autel, au trot, au trot, et tant pis pour l’essieu qui se brise au fourgon des bagages du Prince de Wagram, lequel n’en sait rien, se rongeant les ongles à son habitude, dans la seconde voiture du convoi, et rêve à Mme Visconti, une cassette sur les genoux, bon Dieu, cela fait un bel embrouillamini, une rupture dans le charroi, tirez-moi cette bagnole dans les fossés, oui ou merde ? regardez les chevaux qui se jettent les uns sur les autres, halte ! halte ! et l’on repart, on se reprend, on s’échelonne, au trot, au trot ! vous allez perdre Sa Majesté, perdre le fil de l’Histoire, laisser passer la suite de ce feuilleton héroïcomique, bougres de cons, serrez, serrez, au trot ! il ne faut pas que se relâche la panique, que la peur ait des trous, la fuite des repos, serrez, serrez, nous n’avons que ça en commun, la blême épouvante qui gargouille dans les estomacs des nobles voyageurs et fait voler le manteau des cavaliers à la première lueur de l’aube.